La culture des céréales occupe une place centrale dans l’agriculture bretonne. Blé, orge, avoine ou maïs façonnent les paysages de la région et contribuent à son équilibre économique et environnemental. Au-delà de leur rôle dans l’alimentation humaine et animale, ces cultures participent à la valorisation du territoire et à la sécurité alimentaire locale. Parmi les acteurs majeurs du secteur, la coopérative Eureden joue un rôle déterminant. Elle structure la filière céréalière à travers ses activités de collecte, de stockage, de séchage et de commercialisation.
Cet article propose un aperçu complet du contexte agricole breton : les principales productions céréalières, les défis auxquels la filière fait face — qu’ils soient agronomiques, climatiques ou économiques —, les innovations en cours et les perspectives d’avenir pour la culture des céréales en Bretagne.
Contexte agricole et potentiel de la Bretagne pour les grandes cultures
Une région historiquement tournée vers l’agriculture
Si la Bretagne est traditionnellement associée à la production laitière ou aux cultures légumières, elle possède pourtant des atouts géographiques et pédoclimatiques non négligeables pour la culture céréalière en Bretagne. La diversité de ses sols, ses ressources en eau (plutôt stables), ainsi qu’un tissu d’exploitations agricoles organisé (coopératives, groupes…) favorisent l’organisation de filière.Néanmoins, la Bretagne n’est pas épargnée par les contraintes : un climat océanique avec des pluies parfois abondantes, des périodes sèches, des risques de lessivage et une forte pression foncière notamment en zones périurbaines ou littorales.
Place des grandes cultures dans le bassin breton
Si les grandes cultures (céréales, oléoprotéagineux…) ne constituent pas le type d’exploitation dominant sur tous les territoires, elles représentent toutefois un maillon important de la chaîne agricole bretonne. Elles constituent le support nécessaire à l’alimentation du cheptel (ensilage de maïs ou orge), à la réalisation de semences ou à une production plus spécialisée (farines locales, biocarburants, marchés d’exportation…). D’où un double enjeu : garantir une production locale diversifiée et rémunératrice en rapport avec les attentes du consommateur tout en respectant les équilibres agricoles, environnementaux et économiques.
Les principales céréales cultivées et leurs spécificités en Bretagne
Blé tendre
Le blé tendre figure souvent parmi les premières céréales en quantité dans la culture bretonne. De par son usage dans la meunerie et l’alimentation humaine (farines), notre territoire se doit de produire un blé de qualité (taux de protéines, teneur en gluten, taux d’impuretés…) malgré un climat parfois humide.
Orge et avoine
L’orge d’hiver ou de printemps entre principalement dans l’alimentation animale (brasserie, alimentation bovine) tandis que l’avoine s’investit parfois plus localement en agronomie, lié aux filières bio ou aux débouchés niches (alimentation animale, marché “healthy”…)
Maïs (grain et fourrage)
Le maïs grain s’empare de certaines zones du territoire, là où le climat le permet (ensoleillement suffisant). Plus gourmand en chaleur et en précipitations favorables, il est moins cultivé que le maïs fourrage, plus fréquent dans les bassins d’élevage.
Céréales secondaires et petits grains
Bien que plus anecdotiques selon les rotations et les teneurs recherchées (seigle, triticale…), d’autres céréales ont également leur place dans les cultures bretonnes. Moins courantes que les précédentes elles présentent cependant un intérêt agronomique certain (diversification des cultures, tolérance à une condition particulière…).
Quels sont les enjeux majeurs pour la culture céréalière en Bretagne ?
 Les contraintes climatiques et agronomiques
Les contraintes climatiques et agronomiques
- Excès d’humidité, lessivage, nitrates… : le climat océanique entraîne régulièrement des périodes de pluie forte pouvant provoquer des pertes de nutriments ou des problèmes de drainage forcé.
- Risques de gel, aléas météorologiques… : les forte variations thermiques, gelées tardives ou printemps humides peuvent perturber le cycle végétatif et le développement normal des plantes.
- Pression phytosanitaire… : l’humidité ambiante favorise certaines maladies fongiques (rouilles foliaires des céréales/colza/lin ; septoriose du blé ; mildiou du lin…), nécessitant une gestion rigoureuse des traitements phytosanitaires via la stratégie de rotation et la diversité variétale.
- Mauvaise qualité des sols ; remontées minérales… : fertilisation/nutriments minéraux disponibles/pH/matière organique/structure… chaque paramètre du sol doit être surveillé avec soin.
Contrainte économique et de marché
- Coût de la production : les coûts liés aux intrants (engrais, semences, produits phytosanitaires) et les matériels (machines agricoles, irrigation) pèsent lourdement dans l’équilibre économique des exploitations.
- Volatilité des prix des céréales : les cours des marchés internationaux conditionnent largement les revenus des producteurs.
- Pression foncière et concurrence avec d’autres usages : certaines terres agricoles proches des villes ou du littoral peuvent être recherchées pour d’autres usages que la production agricole (aménagement, habitat).
- Exigences de qualité et de traçabilité : les filières imposent de plus en plus de garanties : sécurité, origine, labels…
Enjeux environnementaux et réglementaires
- Réglementation liée aux nitrates, pesticides, protection des eaux…: le respect de normes environnementales est un impératif auquel doivent se soumettre les exploitants agricoles.
- Préservation de la biodiversité, des sols, du carbone…: les consommateurs et l’opinion publique attendent que les filières adoptent des pratiques plus soutenables réduisant l’érosion des sols par exemple et contribuant à la lutte contre le changement climatique.
- Transitions vers une agriculture durable / bio… : certaines exploitations vont devoir intégrer à court terme dans leurs pratiques des contraintes plus fortes tout en préservant leur rentabilité.
Levées d’innovations, leviers technologiques et pratiques agronomiques
Sélection variétale et semences adaptées
L’adoption de variétés plus tolérantes à l’humidité, aux maladies ou aux stress hydriques est un levier incontournable. Le choix de semences certifiées, le recours à des mélanges variétaux, la recherche de diversité variétale constituent autant de voies pour gagner en résilience.
Agriculture de précision et outils numériques
Les technologies d’agriculture numérique (capteurs, drones, imagerie satellite, cartes de rendement, modulation intra‑parcellaire…) permettent d’optimiser les différents intrants (fertilisation, irrigation, traitements…). Ces outils aident à adapter les apports aux différentes zones du champ et par conséquent à réduire les coûts et minimiser l’impact sur l’environnement.
Couplage avec l’agroécologie
L’introduction de couverts végétaux, de rotations diversifiées, de légumineuses en interculture ou en mélange, ou encore d’itinéraires techniques moins dépendants des intrants chimiques permet de préserver la fertilité des sols, limiter le développement des maladies et améliorer la résilience face aux aléas.
Stockage, séchage, logistique de proximité
Un enjeu majeur pour la culture céréalière en Bretagne, c’est la logistique : collecter, sécher stocker et acheminer les grains selon des critères qualitatifs. Les coopératives ont un rôle primordial à jouer pour mutualiser les installations de stockage et séchage ainsi que les circuits de collecte.
Valorisation et circuits locaux
Développer des filières locales (farines bretonnes, circuits courts, transformation locale…) permet de mieux valoriser les céréales bretonnes en se rapprochant du consommateur. L’émergence récente de coopératives artisanales comme Bretagne Farine, de moulins locaux ou encore d’initiatives territoriales comme C’est qui le patron ?!, constituent autant d’atouts pour renforcer la valeur ajoutée locale.
Focus sur un acteur ou une initiative bretonne : l’exemple d’Eureden dans la filière céréalière
L’importante coopérative Eureden est un partenaire incontournable dans la structuration de la culture céréalière en Bretagne.
Elle assure en effet le bon fonctionnement de la collecte, du stockage, du séchage, de la valorisation et de la commercialisation des céréales livrées par ses adhérents. Ainsi, chaque année, les agriculteurs partenaires d’Eureden livrent leurs céréales et oléoprotéagineux à la coopérative. Grâce à son réseau de collecte de proximité, ses sites de stockage et de séchage, la coopérative garantit la valorisation et la sécurisation des débouchés de ces productions céréalières. Mais Eureden ne s’y limite pas : elle accompagne ses adhérents sur le plan technique. En effet, ses techniciens spécialisés en productions végétales suivent la qualité des céréales du champ au silo.
Eureden met aussi à disposition des Outils modernes de commercialisation (comme l’application digitale consacrée “Côté marché”) pour permettre aux agriculteurs de vendre leurs céréales dans les meilleures conditions.
Enfin, et non des moindres, Eureden assure les importantes certifications comme CSA-GTP, qui garantissent la traçabilité sanitaire et la qualité des grains stockés et commercialisés.Ainsi, cet exemple illustre bien comment, dans le contexte breton, une coopérative structurante peut agir pour amener vers plus de compétitivité, plus de résilience et plus de pérennité (environnementale comme économique) une filière céréalière territoriale.
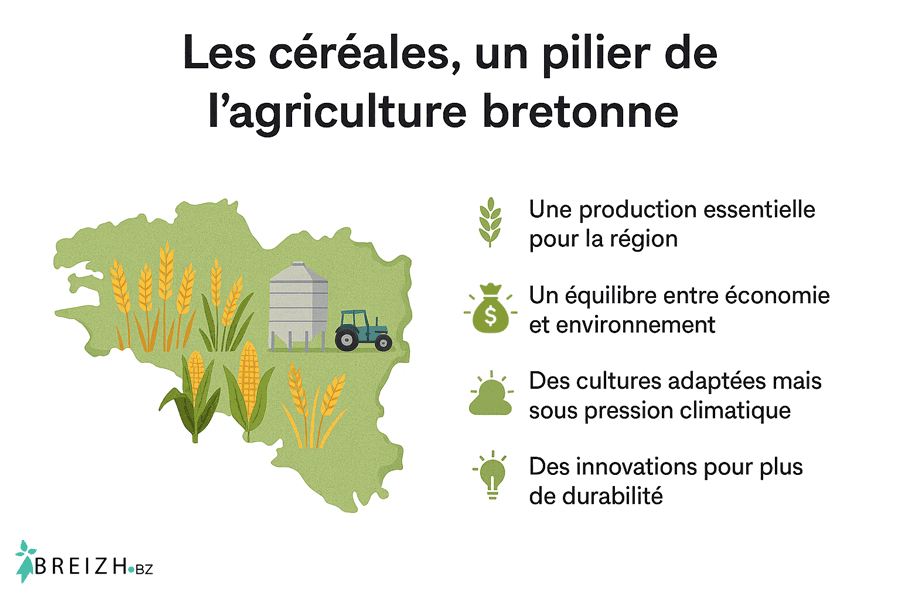
Les pistes et recommandations pour renforcer la culture céréalière en Bretagne
Renforcer les synergies territoriales
Les collectivités, les chambres d’agriculture, les syndicats agricoles et les acteurs privés doivent renforcer les coopérations territoriales : organiser des plates‑formes de collecte, mutualiser des installations de stockage/séchage, créer des projets de valorisation locale.
Soutenir la transition agronomique
Encourager financièrement et techniquement la transition vers des pratiques plus durables (réduction d’intrants, couverts végétaux, rotations longues) via des aides publiques, des dispositifs d’accompagnement, des expérimentations et des retours d’expérience.
Investir dans la recherche et l’innovation
Développer la recherche agronomique adaptée au contexte breton (variétés résistantes, systèmes de culture robustes aux aléas, outils de pilotage) est indispensable. Diffuser rapidement les innovations vers les exploitations.
Développer les filières de valorisation locale
Créer et soutenir des moulins, meuneries ou projets de transformation localisés afin de pouvoir transformer sur place les céréales , renforcer la valeur ajoutée du territoire et favoriser les circuits courts. De plus en plus le consommateur fait attention à l’origine locale du produit.
Améliorer les capacités logistiques
accroître les capacités de stockage/séchage/transport local tout en optimisant les flux (mutualisation, segmentation des lots selon qualité…) afin d’éviter le maximum de pertes, garantir au mieux les qualités et maximiser les revenus est fondamental.
Communication – image de la filière – sensibilisation
Valoriser l’image de la céréale bretonne auprès du grand public, des transformateurs et dans certaines filières alimentaires (pâtisseries/boulangerie/alimentation bio…) pourra permettre aux producteurs d’être mieux rémunérés et ainsi augmenter la part de marché des céréales locales.



